karl marx — critique du programme de gotha (I)
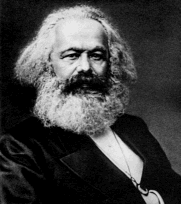
Rédigé par Marx en avril et au début de mai 1875. Publié pour la première fois (avec des coupures) dans
AVANT-PROPOS DE FRIEDRICH ENGELS
Le manuscrit imprimé ci-dessous — la lettre de présentation à Bracke aussi bien que la critique du projet de programme, — fut adressé à Bracke en 1875, peu de temps avant le congrès d'unification de Gotha2, pour être communiqué à Geib, Auer, Bebel et Liebknecht puis renvoyé ensuite à Marx. Le congrès de Halle3 ayant mis à l'ordre du jour du Parti la discussion du programme de Gotha, je croirais commettre un détournement si je dérobais plus longtemps à la publicité ce document considérable, le plus considérable peut-être de ceux qui concernent cette discussion.
Mais le manuscrit a encore une autre portée et de beaucoup plus grande. Pour la première fois, on y trouve clairement et solidement établie la position prise par Marx en face des tendances inaugurées par Lassalle dès son entrée dans le mouvement, tant en ce qui concerne à la fois les principes économiques que la tactique.
L'impitoyable sévérité avec laquelle le projet de programme est analysé, l'inflexibilité avec laquelle les résultats obtenus sont énoncés et les points faibles du projet mis à nu, ne peuvent plus blesser aujourd'hui, alors que quinze ans se sont écoulés. Des Lassalliens spécifiques, il n'en existe plus qu'à l'étranger, ruines solitaires, et à Halle le programme de Gotha a été abandonné même par ses auteurs, comme absolument insuffisant.
Malgré cela, j'ai retranché, là où la chose était indifférente, et remplacé par des points quelques expressions ou appréciations âprement personnelles. Marx le ferait lui-même, s'il publiait aujourd'hui son manuscrit. La vivacité de langage qu'on y rencontre parfois s'expliquait par deux circonstances. D'abord nous étions, Marx et moi, mêlés au mouvement allemand plus intimement qu'à tout autre; la régression manifeste dont témoignait le projet de programme devait nous émouvoir tout particulièrement. En second lieu, nous étions à ce moment, deux ans à peine après le congrès de
Il y a, en outre, quelques phrases qui, pour des raisons de censure, sont remplacées par des points. Là où je devais choisir une expression atténuée, je l'ai mise entre crochets. A cela près, la reproduction est textuelle.
F.. Engels
Londres, 6 janvier 1891
LETTRE DE KARL MARX A WILHELM BRACKE
Londres, 5 mai
Mon cher Bracke,
Les gloses marginales qui suivent, critique du programme d'unification, ayez l'amabilité de les porter, après lecture, à la connaissance de Geib et d'Auer, de Bebel et de Liebknecht. Je suis surchargé de travail et fais déjà beaucoup plus que ce qui m'est prescrit par les médecins. Aussi n'est-ce nullement pour mon «plaisir» que j'ai griffonné ce long papier. Cela n'en était pas moins indispensable pour que, par la suite, les démarches que je pourrais être amené à faire ne pussent être mal interprétées par les amis du Parti auxquels est destinée cette communication.
Après le congrès d'unification nous publierons, Engels et moi, une brève déclaration dans laquelle nous indiquerons que nous n'avons rien de commun avec le programme de principe en question. Cela est indispensable puisqu'on répand à l'étranger l'opinion soigneusement entretenue par les ennemis du Parti, — opinion absolument erronée, — que nous dirigeons ici, en secret, le mouvement du Parti dit d'Eisenach. Dans un écrit russe tout récemment paru5, Bakounine, par exemple, me rend responsable non seulement de tous les programmes, etc., de ce Parti, mais encore de tout ce qu'a fait Liebknecht dès le premier jour de sa collaboration avec le Parti populaire (Volkspartei).
Cela mis à part, c'est pour moi un devoir de ne pas reconnaître, fût-ce par un diplomatique silence, un programme qui, j'en suis convaincu, est absolument condamnable et qui démoralise le Parti.
Tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une douzaine de programmes. Si donc on se trouvait dans l'impossibilité de dépasser le programme d'Eisenach, — et les circonstances ne le permettaient pas, — on devait se borner à conclure un accord pour l'action contre l'ennemi commun. Si on fabrique, au contraire, des programmes de principes (au lieu d'ajourner cela à une époque où pareils programmes eussent été préparés par une longue activité commune), on pose publiquement des jalons qui indiqueront au monde entier le niveau du mouvement du Parti. Les chefs des Lassalliens venaient à nous, poussés par les circonstances. Si on leur avait déclaré dès l'abord qu'on ne s'engagerait dans aucun marchandage de principes, il leur eût bien fallu se contenter d'un programme d'action ou d'un plan d'organisation en vue de l'action commune. Au lieu de cela, on leur permet de se présenter munis de mandats qu'on reconnaît soi-même avoir force obligatoire, et ainsi on se rend à la discrétion de gens qui ont besoin de vous. Pour couronner le tout, ils tiennent un nouveau congrès avant le congrès de compromis, tandis que notre Parti tient le sien post festum. On voulait manifestement escamoter toute critique et bannir toute réflexion de notre propre Parti. On sait que le seul fait de l'union donne satisfaction aux ouvriers, mais on se trompe si l'on pense que ce résultat immédiat n'est pas trop chèrement payé.
Au surplus, le programme ne vaut rien, même si l'on fait abstraction de la canonisation des articles de foi lassalliens. Je vous enverrai bientôt les derniers fascicules de l'édition française du Capital. L'édition en a été longtemps suspendue, par suite de l'interdiction du gouvernement français. Cette semaine-ci, ou au commencement de la semaine prochaine, l'édition sera terminée. Avez-vous eu les six premiers fascicules ? Veuillez me procurer l'adresse de Bernhard Becker à qui je dois envoyer les derniers7.
La librairie du Volksstaat8 a des manières à elle. C'est ainsi que, par exemple, on ne m'a pas encore adressé un seul exemplaire imprimé du Procès des communistes de Cologne9.
Meilleures salutations.
Votre Karl Marx
GLOSES MARGINALES AU PROGRAMME
DU PARTI OUVRIER ALLEMAND
I
1. «Le travail est la source de toute richesse et de toute culture, et comme le travail productif n'est possible que dans la société et par la société, son produit appartient intégralement, par droit égal, à tous les membres de la société.»
Première partie du paragraphe : «Le travail est la source de toute richesse et de toute culture.»
Le travail n'est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle !) que le travail, qui n'est lui-même que l'expression d'une force naturelle, la force de travail de l'homme. Cette phrase rebattue se trouve dans tous les abécédaires, et elle n'est vraie qu'à condition d'entendre que le travail se fait en intégrant tous les objets et procédés qui s'y rapportent. Mais un programme socialiste ne saurait permettre à cette phraséologie bourgeoise de passer sous silence les conditions qui, seules, peuvent lui donner un sens. Et ce n'est qu'autant que l'homme, dès l'abord, agit en propriétaire à l'égard de la nature, cette source première de tous les moyens et matériaux de travail, ce n'est que s'il la traite comme un objet lui appartenant que son travail devient la source des valeurs d'usage, partant de la richesse. Les bourgeois ont d'excellentes raisons pour attribuer au travail cette surnaturelle puissance de création : car, du fait que le travail est dans la dépendance de la nature, il s'ensuit que l'homme qui ne possède rien d'autre que sa force de travail sera forcément, en tout état de société et de civilisation, l'esclave d'autres hommes qui se seront érigés en détenteurs des conditions objectives du travail. Il ne peut travailler, et vivre par conséquent, qu'avec la permission de ces derniers.
Mais laissons la proposition telle qu'elle, ou plutôt si boiteuse qu'elle soit. Quelle conclusion en devrait-on attendre ? Evidemment celle-ci :
«Puisque le travail est la source de toute richesse, nul dans la société ne peut s'approprier des richesses qui ne soient un produit du travail. Si donc quelqu'un ne travaille pas lui-même, il vit du travail d'autrui et, même sa culture, il la tire du travail d'autrui.»
Au lieu de cela, à la première proposition, on en ajoute une seconde par le moyen du mot-cheville : «et comme», pour tirer de la seconde, et non de l'autre, la conséquence finale.
Deuxième partie du paragraphe : «Le travail productif n'est possible que dans la société et par la société.»
D'après la première proposition, le travail était la source de toute richesse et de toute culture, donc pas de société possible sans travail. Et voilà que nous apprenons au contraire que le travail «productif» n'est pas possible sans société.
On aurait pu dire, tout aussi bien, que c'est seulement dans la société que le travail inutile, et même socialement nuisible, peut devenir une branche d'industrie, que c'est seulement dans la société qu'on peut vivre de l'oisiveté, etc., etc. — bref recopier tout Rousseau.
Et qu'est-ce qu'un travail «productif» ? Ce ne peut être que le travail qui produit l'effet utile qu'on se propose. Un sauvage, — et l'homme est un sauvage après avoir cessé d'être un singe, — qui abat une bête d'un coup de pierre, qui récolte des fruits, etc., accomplit un travail «productif».
Troisièmement. Conclusion : «Et comme le travail productif n'est possible que dans la société et par la société, son produit appartient intégralement, par droit égal, à tous les membres de la société.»
Belle conclusion ! Si le travail productif n'est possible que dans la société et par la société, son produit appartient à la société, — et, au travailleur individuel, il ne revient rien de plus que ce qui n'est pas indispensable au maintien de la société, «condition» même du travail.
En fait, cette proposition a toujours été défendue par les champions de l'ordre social existant, à chaque époque. En premier viennent les prétentions du gouvernement, avec tout ce qui s'ensuit, car le gouvernement est l'organe de la société chargé du maintien de l'ordre social ; puis viennent les prétentions des diverses sortes de propriété privée (Cf. Œuvres complètes de Marx et Engels, éd. allemande, tome 19 : «propriétaires».), qui, toutes, sont le fondement de la société, etc. On le voit, ces phrases creuses peuvent être tournées et retournées dans le sens qu'on veut.
Il n'y a de lien logique entre la première et la seconde partie du paragraphe que si l'on adopte la rédaction suivante :
«Le travail n'est la source de la richesse et de la culture que s'il est un travail social», ou, ce qui revient au même : «que s'il s'accomplit dans la société et par elle».
Thèse incontestablement exacte, car le travail isolé (en supposant réalisées ses conditions matérielles), s'il peut créer des valeurs d'usage, ne peut créer ni richesse ni culture.
Autre thèse non moins incontestable :
«Dans la mesure où le travail évolue en travail social et devient ainsi source de richesse et de culture, se développent, chez le travailleur, la pauvreté et l'abandon, chez le non-travailleur, la richesse et la culture.»
Telle est la loi de toute l'histoire jusqu'à ce jour. Au lieu de faire des phrases générales sur le «travail» et la «société», il fallait donc indiquer ici avec précision comment, dans, la société capitaliste actuelle, sont finalement créées les conditions matérielles et autres qui habilitent et obligent le travailleur à briser cette malédiction sociale. (Cf. Œuvres complètes de Marx et Engels, éd. allemande, tome 19 : «malédiction historique».)
Mais, en fait, tout ce paragraphe, aussi bien raté au point de vue de la forme que du fond, n'est là que pour qu'on puisse inscrire sur le drapeau du Parti, tout en haut, comme mot d'ordre, la formule lassallienne du «produit intégral du travail». Je reviendrai plus loin sur le «produit du travail», le «droit égal», etc., car la même chose reparaît sous une autre forme un peu différente.
2. «Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le monopole de la classe capitaliste. L'état de dépendance qui en résulte pour la classe ouvrière est la cause de la misère et de la servitude sous toutes ses formes.»
La thèse empruntée aux statuts de l'Internationale, est fausse sous cette forme «améliorée».
Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le monopole des propriétaires fonciers (le monopole de la propriété foncière est même la base du monopole capitaliste) et des capitalistes. Les statuts de l'Internationale, dans le passage en question, ne nomment ni l'une ni l'autre classe monopoleuse. Ils parlent du «monopole des moyens de travail, c'est-à-dire des sources de la vie». L'addition des mots : «sources de la vie» montre suffisamment que la terre est comprise parmi les moyens de travail.
On a introduit cette rectification parce que Lassalle, pour des raisons aujourd'hui connues, attaquait seulement la classe capitaliste et non les propriétaires fonciers. En Angleterre, le plus souvent, le capitaliste n'est même pas le propriétaire du sol sur lequel est bâtie sa fabrique.
3. «L'affranchissement du travail exige que les instruments de travail soient élevés à l'état de patrimoine commun de la société et que le travail collectif soit réglementé par la communauté avec partage équitable du produit.»
«Les instruments de travail élevés à l'état de patrimoine commun» (!) cela doit signifier sans doute : «transformés en patrimoine commun». Mais ceci seulement en passant.
Qu'est-ce que c'est que le «produit du travail» ? L'objet créé par le travail ou sa valeur ? Et, dans ce dernier cas, la valeur totale du produit ou seulement la fraction de valeur que le travail est venu ajouter à la valeur des moyens de production consommés ?
Le «produit du travail» est une notion vague qui tenait lieu, chez Lassalle, de conceptions économiques positives.
Qu'est-ce que le «partage équitable» ?
Les bourgeois ne soutiennent-ils pas que le partage actuel est «équitable» ? Et, en fait, sur la base du mode actuel de production, n'est-ce pas le seul partage «équitable» ? Les rapports économiques sont-ils réglés par des idées juridiques ou n'est-ce pas, au contraire, les rapports juridiques qui naissent des rapports économiques ? Les socialistes des sectes n'ont-ils pas, eux aussi, les conceptions les plus diverses de ce partage «équitable» ?
Pour savoir ce qu'il faut entendre en l'occurrence par cette expression creuse de «partage équitable», nous devons confronter le premier paragraphe avec celui-ci. Ce dernier suppose une société dans laquelle «les instruments de travail sont patrimoine commun et où le travail collectif est réglementé par la communauté», tandis que le premier paragraphe nous montre que «le produit appartient intégralement, par droit égal, à tous les membres de la société».
«A tous les membres de la société» ? Même à ceux qui ne travaillent pas ? Que devient alors le «produit intégral du travail» ? Aux seuls membres de la société qui travaillent ? Que devient alors le «droit égal» de tous les membres de la société ?
Mais «tous les membres de la société» et le «droit égal» ne sont manifestement que des façons de parler. Le fond consiste en ceci que, dans cette société communiste, chaque travailleur doit recevoir, à la mode lassallienne, un «produit intégral du travail».
Si nous prenons d'abord le mot «produit du travail» (Arbeitsertrag) dans le sens d'objet créé par le travail (Produkt der Arbeit), alors le produit du travail de la communauté, c'est la totalité du produit social (das gesellschaftliche Gesamtprodukt).
Là-dessus, il faut défalquer :
Premièrement : un fonds destiné au remplacement des moyens de production usagés ;
Deuxièmement : une fraction supplémentaire pour accroître la production ;
Troisièmement : un fonds de réserve ou d'assurance contre les accidents, les perturbations dues à des phénomènes naturels, etc.
Ces défalcations sur le «produit intégral du travail» sont une nécessité économique, dont l'importance sera déterminée en partie, compte tenu de l'état des moyens et des forces en jeu, à l'aide du calcul des probabilités ; en tout cas, elles ne peuvent être calculées en aucune manière sur la base de l'équité.
Reste l'autre partie du produit total, destinée à la consommation.
Mais avant de procéder à la répartition individuelle, il faut encore retrancher :
Premièrement : les frais généraux à!administration qui sont indépendants de la production. (Cf. Œuvres complètes de Marx et Engels, éd. allemande, tome 19 : «qui ne dépendent pas directement de la production».)
Comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, cette fraction se trouve d'emblée réduite au maximum et elle décroît à mesure que se développe la société nouvelle.
Deuxièmement : ce qui est destiné à satisfaire les besoins de la communauté : écoles, installations sanitaires, etc.
Cette fraction gagne d'emblée en importance, comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, et cette importance s'accroît à mesure que se développe la société nouvelle.
Troisièmement : le fonds nécessaire à l'entretien de ceux qui sont incapables de travailler, etc., bref ce qui relève de ce qu'on nomme aujourd'hui l'assistance publique officielle.
C'est alors seulement que nous arrivons au seul «partage» que, sous l'influence de Lassalle et d'une façon bornée, le programme ait en vue, c'est-à-dire à cette fraction des objets de consommation qui est répartie individuellement entre les producteurs de la collectivité.
Le «produit intégral du travail» s'est déjà métamorphosé en sous-main en «produit partiel», bien que ce qui est enlevé au producteur, en tant qu'individu, il le retrouve directement ou indirectement, en tant que membre de la société.
De même que le terme de «produit intégral du travail» s'est évanoui, de même nous allons voir s'évanouir celui de «produit du travail» en général.
Au sein d'un ordre social communautaire, fondé sur la propriété commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits ; de même, le travail incorporé dans les produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce qui se passe dans la société capitaliste, ce n'est plus par la voie d'un détour, mais directement, que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante du travail de la communauté. L'expression : «produit du travail», condamnable même aujourd'hui à cause de son ambiguïté, perd ainsi toute signification.
Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est à une société communiste non pas telle qu'elle s'est développée sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire, telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste ; une société par conséquent, qui, sous tous les rapports, économique, moral, intellectuel, porte encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle est issue. Le producteur reçoit donc individuellement — les défalcations une fois faites — l'équivalent exact de ce qu'il a donné à la société. Ce qu'il lui a donné, c'est son quantum individuel de travail. Par exemple, la journée sociale de travail représente la somme des heures de travail individuel ; le temps de travail individuel de chaque producteur est la portion qu'il a fournie de la journée sociale de travail, la part qu'il y a prise. Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni tant de travail (défalcation faite du travail effectué pour les fonds collectifs) et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux d'objets de consommation autant que coûte une quantité égale de son travail. Le même quantum de travail qu'il a fourni à la société sous une forme, il le reçoit d'elle, en retour, sous une autre forme.
C'est manifestement ici le même principe que celui qui règle l'échange des marchandises pour autant qu'il est échange de valeurs égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les conditions étant différentes, nul ne peut rien fournir d'autre que son travail et que, par ailleurs, rien ne peut entrer dans la propriété de l'individu que des objets de consommation individuelle. Mais pour ce qui est du partage de ces objets entre producteurs pris individuellement, le principe directeur est le même que pour l'échange de marchandises équivalentes: une même quantité de travail sous une forme s'échange contre une même quantité de travail sous une autre forme.
Le droit égal est donc toujours ici, dans son principe... le droit bourgeois, bien que principe et pratique n'y soient plus aux prises, tandis qu'aujourd'hui l'échange d'équivalents n'existe pour les marchandises qu'en moyenne et non dans le cas individuel.
En dépit de ce progrès, le droit égal reste toujours grevé d'une limite bourgeoise. Le droit du producteur est proportionnel au travail qu'il a fourni; l'égalité consiste ici dans l'emploi du travail comme unité de mesure commune.
Mais un individu l'emporte physiquement ou moralement sur un autre, il fournit donc dans le même temps plus de travail ou peut travailler plus de temps ; et pour que le travail puisse servir de mesure, il faut déterminer sa durée ou son intensité, sinon il cesserait d'être unité. Ce droit égal est un droit inégal pour un travail inégal. Il ne reconnaît aucune distinction de classe, parce que tout homme n'est qu'un travailleur comme un autre ; mais il reconnaît tacitement l'inégalité des dons individuels et, par suite, de la capacité de rendement comme des privilèges naturels. (Cf. Œuvres complètes de Marx et Engels, éd. allemande, tome 19 ; on lit : «mais il reconnaît tacitement l'inégalité des dons individuels des travailleurs et, par suite, de leur capacité de rendement comme des privilèges naturels.») C'est donc, dans sa teneur, un droit fondé sur l'inégalité, comme tout droit. Le droit par sa nature ne peut consister que dans l'emploi d'une même unité de mesure; mais les individus inégaux (et ce ne seraient pas des individus distincts, s'ils n'étaient pas inégaux) ne sont mesurables d'après une unité commune qu'autant qu'on les considère d'un même point de vue, qu'on ne les saisit que sous un aspect déterminé ; par exemple, dans le cas présent, qu'on ne les considère que comme travailleurs et rien de plus, et que l'on fait abstraction de tout le reste. D'autre part: un ouvrier est marié, l'autre non; l'un a plus d'enfants que l'autre, etc., etc. A égalité de travail et, par conséquent, à égalité de participation au fonds social de consommation, l'un reçoit donc effectivement plus que l'autre, l'un est plus riche que l'autre, etc. Pour éviter tous ces inconvénients, le droit devrait être non pas égal, mais inégal.
Mais ces défauts sont inévitables dans la première phase de la société communiste, telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste, après un long et douloureux enfantement. Le droit ne peut jamais être plus élevé que l'état économique de la société et que le degré de civilisation qui y correspond.
Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissante subordination des individus à la division du travail et, avec elle, l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel ; quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital ; quand, avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : «De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !»
Je me suis particulièrement étendu sur le «produit intégral du travail», ainsi que sur le «droit égal», le «partage équitable», afin de montrer combien criminelle est l'entreprise de ceux qui, d'une part, veulent imposer derechef à notre Parti, comme des dogmes, des conceptions qui ont signifié quelque chose à une certaine époque, mais ne sont plus aujourd'hui qu'une phraséologie désuète, et d'autre part, faussent la conception réaliste inculquée à grand'peine au Parti, mais aujourd'hui bien enracinée en lui, et cela à l'aide des fariboles d'une idéologie juridique ou autre, si familières aux démocrates et aux socialistes français.
Abstraction faite de ce qui vient d'être dit, c'était de toute façon une erreur que de faire tant de cas de ce qu'on nomme le partage, et de mettre l'accent sur lui.
A toute époque, la répartition des objets de consommation n'est que la conséquence de la manière dont les conditions de la production sont elles-mêmes réparties. Mais cette répartition est un caractère du mode de production lui-même. Le mode de production capitaliste, par exemple, consiste en ceci que les conditions matérielles de production sont attribuées aux non-travailleurs sous forme de propriété capitaliste et de propriété foncière, tandis que la masse ne possède que les conditions personnelles de production: la force de travail. Si les éléments de la production sont répartis de la sorte, la répartition actuelle des objets de consommation en résulte d'elle-même. Que les conditions matérielles de la production soient la propriété collective des travailleurs eux-mêmes, une répartition des objets de consommation différente de celle d'aujourd'hui s'ensuivra pareillement. Le socialisme vulgaire (et par lui, à son tour, une fraction de la démocratie) a hérité des économistes bourgeois l'habitude de considérer et de traiter la répartition comme une chose indépendante du mode de production et de représenter pour cette raison le socialisme comme tournant essentiellement autour de la répartition. Les rapports réels ayant été depuis longtemps élucidés, à quoi bon revenir en arrière ?
4. «L'affranchissement du travail doit être l'œuvre de la classe ouvrière, en face de laquelle toutes les autres classes ne forment qu'une masse réactionnaire.»
La première strophe provient du préambule des statuts de l'Internationale, mais sous une forme «améliorée». Le préambule dit : «L'affranchissement de la classe des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes» ; tandis qu'ici c'est la «classe des travailleurs» qui doit affranchir — quoi ? le «travail». Comprenne qui pourra.
Comme pour compenser, l'antistrophe est, une citation lassallienne de la plus belle eau : « [la classe ouvrière] en face de laquelle toutes les autres classes ne forment qu'une masse réactionnaire. »
Dans le Manifeste communiste, il est dit : «De toutes les classes qui, à l'heure présente, s'opposent à la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent et périssent avec la grande industrie ; le prolétariat, au contraire, en est le produit le plus authentique.»10
La bourgeoisie est ici considérée comme une classe révolutionnaire, — en tant qu'elle est l'agent de la grande industrie, — vis-à-vis des féodaux et des classes moyennes résolus à maintenir toutes les positions sociales qui sont le produit de modes de production périmés. Féodaux et classes moyennes ne forment donc pas avec la bourgeoisie une même masse réactionnaire.
D'autre part, le prolétariat est révolutionnaire vis-à-vis de la bourgeoisie parce que, issu lui-même de la grande industrie, il tend à dépouiller la production de son caractère capitaliste que la bourgeoisie cherche à perpétuer. Mais le Manifeste ajoute que «les classes moyennes... sont révolutionnaires... en considération de leur passage imminent au prolétariat».
De ce point de vue, c'est donc une absurdité de plus que de faire des classes moyennes, conjointement avec la bourgeoisie, et, par-dessus le marché, des féodaux «une même masse réactionnaire» en face de la classe ouvrière.
Lors des dernières élections11, a-t-on crié aux artisans, aux petits industriels, etc., et aux paysans : «Vis-à-vis de nous, vous ne formez, avec les bourgeois et les féodaux, qu'une seule masse réactionnaire» ?
Lassalle savait par cœur le Manifeste communiste, de même que ses fidèles savent les saints écrits dont il est l'auteur. S'il le falsifiait aussi grossièrement, ce n'était que pour farder son alliance avec les adversaires absolutistes et féodaux contre la bourgeoisie.
Dans le paragraphe précité, sa maxime est d'ailleurs fort tirée par les cheveux, sans aucun rapport avec la citation défigurée des statuts de l'Internationale. Il s'agit donc ici simplement d'une impertinence et, à la vérité, une impertinence qui ne peut être nullement déplaisante aux yeux de M. Bismarck, une de ces grossièretés à bon compte comme en confectionne le Marat berlinois12.
(suite II)
A découvrir aussi
- marx et engels, adresse du comité central à la ligue des communistes
- karl marx — critique du programme de gotha (III)
- karl marx — critique du programme de gotha (V)
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 839 autres membres
